Lutter contre les champignons et étudier les agents pathogènes, un pied dans la forêt et l’autre en laboratoire.
Septembre 2025
Nicolas Feau ne se destinait pas à une carrière de pathologiste forestier. Mais la graine a été semée quand, enfant, il parcourait la forêt à la recherche de champignons avec ses parents. Aujourd’hui, ce chercheur scientifique au Service canadien des forêts (SCF) de RNCan joue un rôle crucial dans la recherche sur les forêts et les changements climatiques.
Rattaché au Centre de foresterie du Pacifique du SCF à Victoria, en Colombie-Britannique, mais aussi professeur associé à la Faculté de foresterie de l’Université de la Colombie-Britannique, Nicolas étudie l’évolution de divers agents pathogènes (p. ex. les oomycètes inhabituels ou les champignons agressifs) et leurs impacts sur les forêts canadiennes. Armé de semis, d’outils génétiques et d’une passion de longue date pour le plein air, il cherche des façons d’aider nos forêts à conserver leur équilibre écologique.
Nous avons discuté avec Nicolas de la valeur de la patience en recherche forestière, des nouvelles technologies qui l’enthousiasment et de l’importance des collaborations scientifiques.
Qu’est-ce qui vous a donné envie de faire carrière en pathologie forestière?
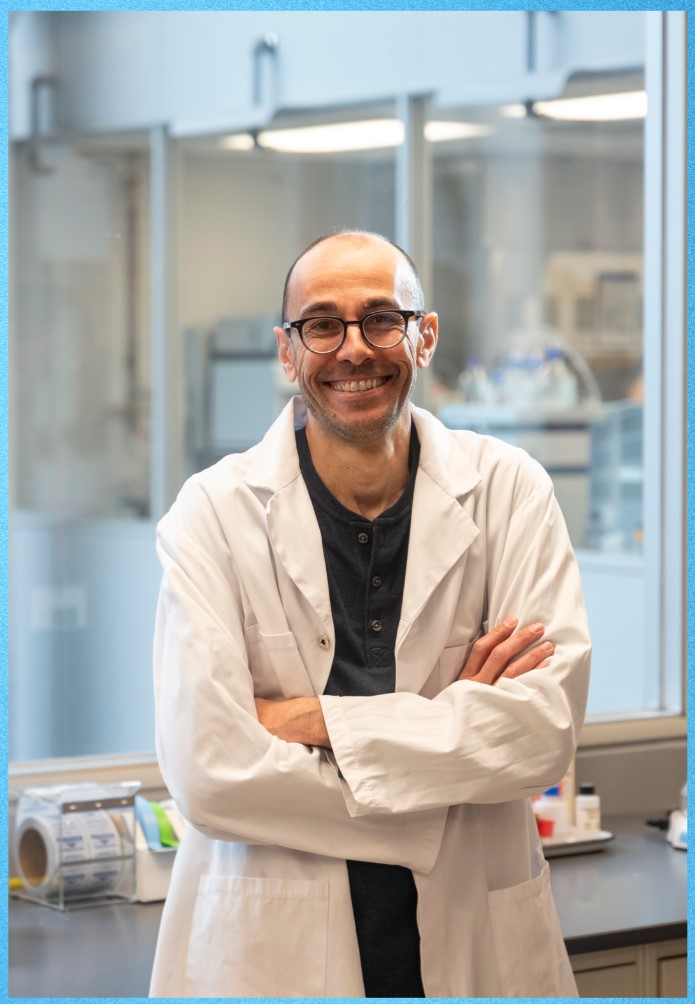
Nicolas Feau, pathologiste forestier, Service canadien des forêts.
Tout d’abord, la forêt : le plein air m’a toujours attiré. Déjà à cinq ans, je cueillais des champignons dans la forêt avec mes parents. J’ai toujours été en communion avec la nature. La pathologie forestière est arrivée plus tard, presque par accident. J’ai suivi un cours de pathologie végétale à l’université et je me suis dit : « ça, c’est intéressant. » Ensuite, j’ai fait une maîtrise en France sur l’interaction entre des peupliers et l’un de leurs pathogènes. C’est là que j’ai compris que je voulais être pathologiste forestier. J’ai alors entrepris un doctorat en biologie forestière à l’Université Laval, à Québec.
En quoi l’étude des arbres et des forêts se distingue-t-elle de celle des autres végétaux?
C’est une question d’échelle. Les arbres sont très différents à cause de leur taille et du temps que mettent les choses à se produire. Une forêt, ce n’est pas comme un champ de maïs ou de fraises : les arbres poussent beaucoup plus lentement, et leurs interactions avec les agents pathogènes peuvent s’étendre sur des années, voire des décennies. Ça rend la recherche plus difficile, mais aussi plus fascinante. Il faut être patient et utiliser des méthodes innovantes pour étudier efficacement ces organismes qui atteignent un âge vénérable.
Qu’est-ce qui vous a attiré vers les champignons et les agents pathogènes?
Les champignons m’ont toujours fasciné. Ils sont très variés et interagissent avec les arbres de façons incroyablement complexes. Certains des agents pathogènes sur lesquels je travaille (les oomycètes, ou moisissures d’eau, comme Phytophthora ramorum) ne sont même pas de vrais champignons : ce sont des agents pathogènes filamenteux plus proches des algues. Mais ils peuvent causer des maladies dévastatrices pour les forêts, p. ex. l’encre des chênes rouges. En comprendre les mécanismes s’avère à la fois difficile et stimulant.
À quoi ressemble votre journée type?
Chaque journée est différente. Un jour, je suis sur le terrain à collecter des échantillons de sols, de racines ou de feuilles d’arbres malades; le lendemain, je suis au labo en train de faire des expériences. De temps en temps, on me demande par courriel d’aller examiner un arbre parce qu’on soupçonne une maladie. Je passe aussi beaucoup de temps à analyser des données, à rédiger des articles pour des publications et à mentorer des étudiants.
J’ai l’impression d’être encore aux études. Pour mon travail, je dois apprendre constamment, lire des publications, apprendre de mes collègues et de mes expériences – les bonnes comme les mauvaises. Mais j’aime aussi le travail manuel. Il y a des expériences que je tiens à faire moi-même parce que j’ai hâte de tester une idée et de voir les résultats. Je pense que j’ai le meilleur boulot au monde – je ne m’ennuie jamais!

Des techniciens évaluent des semis cultivés pour mieux comprendre quels arbres résisteront aux agents pathogènes et aux conditions climatiques dans l’avenir.
Est-il important de savoir collaborer et travailler en équipe dans votre métier?
C’est indispensable. Les relations avec tout le monde qui travaille dans le labo – les techniciens, les étudiants –, c’est primordial. Sans eux, je serais incapable de faire mon travail.
La collaboration avec les collègues est tout aussi importante. De nos jours, il est impossible de faire du bon travail tout seul dans son coin. Il faut échanger des idées et recevoir du feedback. Parfois, les meilleures discussions avec les collègues sont celles qu’on a en se croisant dans un corridor. On est décontracté, il n’y a pas de pression, mais les idées circulent, et l’échange est très constructif. Par exemple, quelqu’un va nous dire : « Tu devrais peut-être essayer ceci » ou « As-tu déjà pensé à cela? », et ces échanges peuvent faire naître des idées brillantes.
Quelles sont les principales menaces qui pèsent sur les forêts?
Les changements climatiques ont un gros impact. Les agents pathogènes qui coexistent avec les arbres depuis des milliers d’années sont aujourd’hui plus virulents à cause des changements environnementaux. Avant, les systèmes étaient en équilibre : les arbres arrivaient à résister, et les agents pathogènes ne causaient que des dégâts mineurs. Mais maintenant, avec le réchauffement et les conditions changeantes, cet équilibre est rompu.
Il y a aussi le commerce mondial, qui introduit de nouveaux agents pathogènes dans des écosystèmes qui n’ont pas de mécanismes de défense naturels contre eux. Par exemple, des spores fongiques ou des ravageurs peuvent traverser des océans dans les caisses de bois utilisées pour le transport de marchandises. Une fois introduits dans de nouveaux milieux, ils peuvent être très dommageables pour les forêts.
Pourquoi ces recherches sont-elles si importantes en ce moment?
On voit de plus en plus de maladies des arbres émerger à cause de la dégradation de l’environnement. Par exemple, l’été en Colombie-Britannique, les arbres souffrent de la sécheresse et de la chaleur. Ces changements touchent aussi les agents pathogènes : ils modifient leurs cycles de vie et leur biologie, ce qui a un effet domino sur les arbres.
Il est important de comprendre ces interactions pour savoir à quoi s’attendre et pouvoir recommander aux forestiers différents types d’arbres capables de résister aux conditions climatiques et aux agents pathogènes du futur.

De nouvelles technologies, comme les phytotrons, permettent d’uniformiser les expériences par un réglage précis des conditions.
Comment entrevoyez-vous l’avenir de la pathologie forestière?
Les outils que nous avons maintenant m’inspirent. Je pense entre autres à la biologie moléculaire et à des biotechnologies comme les techniques d’édition du génome. Ça nous permet de manipuler des organismes vivants d’une manière tout à fait inédite. Par exemple, si je découvre un gène qui selon moi pourrait conférer une résistance à un pathogène, je peux vérifier mon hypothèse en quelques semaines à peine grâce à ces nouveaux outils. Avec les techniques traditionnelles, ça aurait été beaucoup plus long.
C’est fou comme ces technologies font progresser notre compréhension et nous aident à trouver des solutions pour protéger nos forêts.
Quel conseil donneriez-vous à quelqu’un qui songerait à faire carrière en pathologie forestière?
Être enthousiaste. Lire. Réfléchir à ce qu’on a envie de tester et nourrir sa passion pour ce sujet. La science est exigeante. Les journées sont parfois longues, et les choses ne se passent pas toujours comme prévu : articles rejetés, expériences ratées, etc. Mais quand on a la flamme, ça vaut vraiment le coup.
La pathologie forestière est particulièrement gratifiante parce qu’on a un pied dans la forêt et l’autre dans le labo, et qu’on travaille avec des organismes vivants pour comprendre leurs interactions. C’est ce qui m’anime.
Complément d’information
Pour en savoir plus, on peut consulter la base de données du SCF sur les arbres, insectes, acariens et maladies des forêts du Canada, qui fournit des renseignements détaillés sur plus de 400 insectes, champignons, virus et autres agents de détérioration qui peuvent nuire à plus de 200 arbres indigènes dans les zones naturelles, rurales et urbaines du Canada.